La ville d’aujourd’hui est- elle plus bruyante que celle d’hier ?
28 juillet 2016 - 08:00
PERCEPTION. Si le bruit est aujourd’hui l’une des sources majeures de nuisance dans les villes, ces dernières ne sont pas pour autant plus bruyantes qu’auparavant. Selon Olivier Balaÿ, architecte et chercheur sur l’histoire du son, c’est surtout la nature du bruit qui a évolué.
Neuf millions de Français sont fortement exposés au bruit des transports. C’est le résultat d’une étude financée par l’ADEME et rendue publique par le Conseil national du bruit, en juin dernier. En ajoutant à cela les impacts sur la santé, l’immobilier, le travail ou l’école, ainsi que les bruits liés au voisinage, la même étude a estimé le coût du bruit en France. Une facture qui atteint au total 57 milliards d’euros, soit près de trois fois celle liée à la pollution de l’air. On peut bien sûr mégoter sur cette estimation qui voit large mais une chose est sûre, le sujet est devenu une préoccupation majeure. Près de la moitié de la population se dit gênée par le bruit.
Pourtant selon Olivier Balaÿ, architecte et chercheur au Cresson, le Centre de recherche sur l’espace sonore et l’environnement urbain installé à Lyon, nous ne vivons pas dans un environnement plus bruyant qu’autrefois : « Les villes d’antan étaient au moins aussi bruyantes qu’aujourd’hui, si ce n’est plus. À Rome, dans l’Antiquité, la ville grouillait de bruits : les rues étaient pavées et le passage des chariots résonnait très fortement ». Que s’est-il donc passé pour que le bruit soit aujourd’hui systématiquement synonyme de nuisance ? Pour le chercheur, la cassure date du XIXe siècle et serait plus liée à l’évolution de la qualité du bruit plutôt qu’à sa quantité : « Avant, la ville était pleine de sons de métiers, d’animaux… Des sons humains, variés et discontinus. Avec l’industrialisation et l’élargissement des rues dans la ville haussmannienne, c’est devenu une sorte de bourdonnement perpétuel. On est passé des bruits au bruit, au singulier. Or, l’oreille préfère les discontinuités, on aime avoir des variations acoustiques ». Face à cette révolution sonore, ce sont les “bourgeois” de l’époque qui, les premiers, se plaignent du bruit et défendent leur quiétude, initiant « l’attitude défensive que l’on retrouve aujourd’hui chez certains habitants de zones pavillonnaires qui se mobilisent contre la création d’immeubles collectifs près de chez eux », estime l’expert. Mais, si l’intolérance au bruit a gagné du terrain, c’est aussi le fait des autorités qui ont toujours privilégié le progrès au détriment de la qualité de l’environnement. Quand autrefois la population « s’autorégulait », selon les termes du chercheur, le vivre-ensemble s’est depuis grandement fragilisé. Et dans un pays qui s’est développé sur l’idéal de la maison individuelle posée au milieu du terrain, ce sont les populations les plus précaires, massées dans les grands ensembles, qui sont aujourd’hui le plus exposées aux nuisances sonores.
Pour Olivier Balaÿ, la solution passe par un total changement d’approche. Plutôt que de séparer espaces publics et privés, il faudrait considérer l’environnement dans sa globalité : « Quand on transforme une voie en rue piétonne, c’est une bêtise. On ne prend pas en compte la perception depuis les habitations, or c’est l’enfer. Tout comme le fait d’isoler à tout prix les habitations des bruits extérieurs n’a fait qu’augmenter la perception des sons à l’intérieur des bâtiments, ce qui génère de nombreux conflits. Il faut une approche mixte, nous avons beaucoup de retard sur cette question mais les mentalités sont en train d’évoluer, on ne peut pas vivre les fenêtres fermées ».
©Marine Mugnier – source Toulouse Métropole
A lire aussi : Nuisances sonores : trop de bruit pour rien ?
A lire aussi : Le bruit n’est pas une fatalité
A lire aussi : Les bons plans de Louis
A lire aussi : Et si l’on apprenait à écouter la ville ?
A lire aussi : Les solutions de la semaine











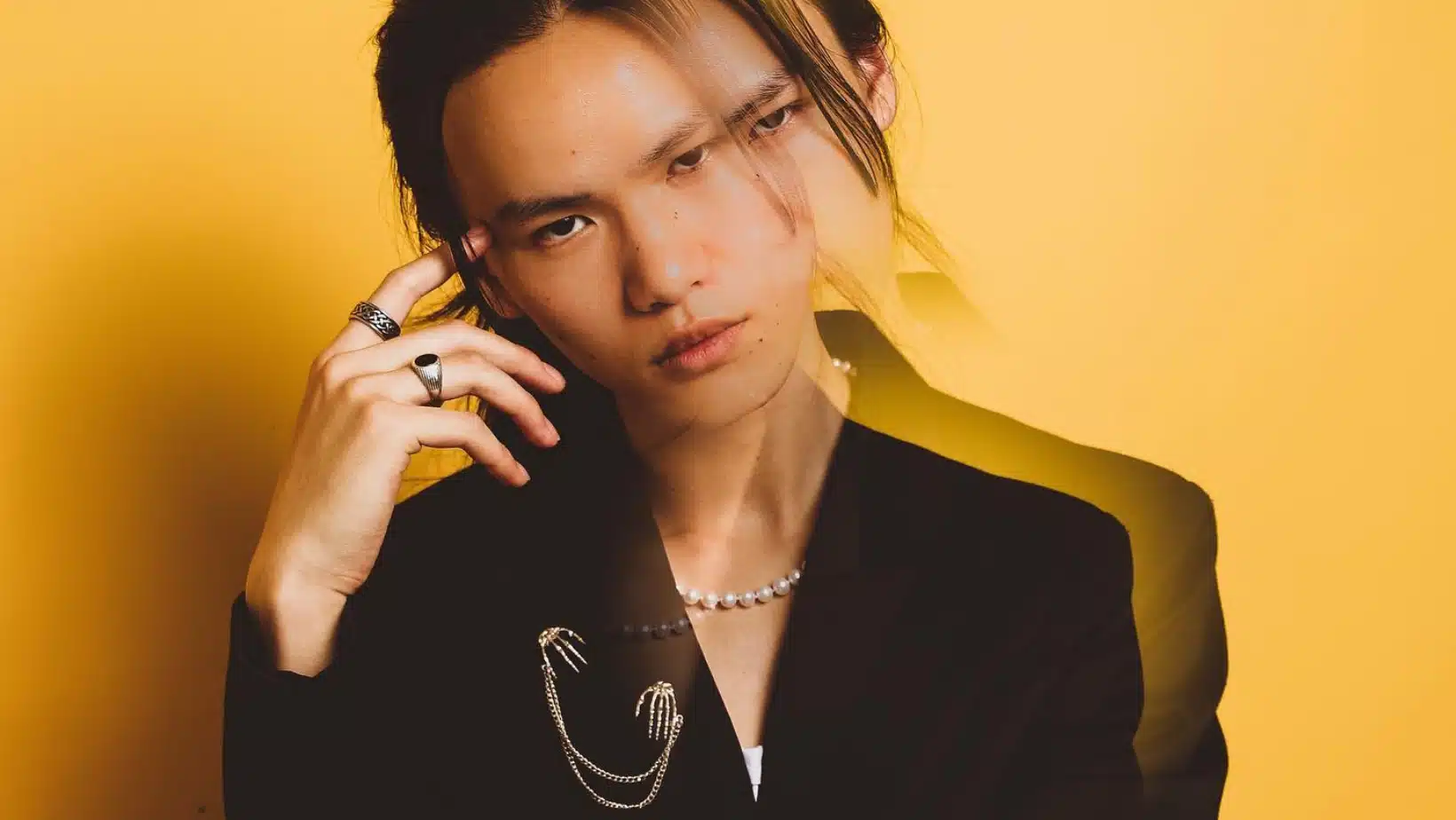


Commentaires