Les enfants, pierre angulaire du changement
10 mars 2021 - 16:16
En 50 ans, les attentes éducatives ont bien évolué, que se soit à l’école ou au sein de la sphère familiale. Passé du petit citoyen apprenant à un être épanoui qui s’interroge sur le monde, l’enfant est devenu le catalyseur d’un changement que notre société ne peut plus éviter. Désormais, il est confronté et sensibilisé aux grands enjeux contemporains qui l’entourent. Mais quels sont-ils ? Comment ont-ils intégré les modèles d’éducation traditionnels ? Et de quelle manière transmet-on des préoccupations existentielles à nos progénitures ?

On a tous en tête l’image d’Épinal du petit élève modèle, bien propre sur lui, qui récite ses leçons sans se poser de questions outre mesure. Cette caricature de l’enfant d’après-guerre a bien changé, et avec elle, les grands enjeux de notre société et de notre monde. Avant les années 1960-1970, les préoccupations étaient à l’industrialisation, à la révolution agricole et à la promotion de la consommation. C’était les Trente Glorieuses. Mais au fil des années, les paradigmes se sont inversés, les grandes causes se sont transformées et les priorités éducatives se sont déplacées, tant en milieu scolaire qu’au sein même de la famille.
Une évolution observée par les sociologues de l’éducation, à l’image de François Dubet, professeur émérite de l’université de Bordeaux : « Il y a 50 ans, l’école républicaine avait pour mission de fabriquer de bons petits citoyens français, c’est-à-dire des élèves qui apprenaient et connaissaient l’histoire, la géographie et la langue de leur pays. A cette époque, aucun enseignement n’était remis en question, l’école était un sanctuaire et détenait le monopole de l’éducation. » Mais aujourd’hui, la seule instruction ne suffit plus. A côté de l’élève, se trouve l’enfant. En plus de sa réussite scolaire, il doit s’ouvrir au monde, s’épanouir et exprimer sa personnalité. Car il est maintenant appréhendé dans son environnement.
Des citoyens du monde aux responsabilités
Cette nouvelle volonté transforme les schémas éducatifs en profondeur. « On cherche maintenant à former un citoyen dans un monde en mutation, qui exige une compréhension de la démocratie, de l’écologie, de la tolérance… Bref, des valeurs qui n’avaient pas cours dans l’école d’autrefois », analyse François Dubet. D’autant que, désormais, les enfants ne comptent plus uniquement sur l’école pour avoir accès aux informations. Ils ont la possibilité de prendre connaissance de leur environnement par eux-mêmes. Il s’agit donc de les accompagner dans leur découverte de l’humanité, de leur expliquer les grands enjeux contemporains.
C’est dans les années 1970 que ceux-ci ont pénétré les modèles éducatifs. « Ils représentent en réalité la définition de nos responsabilités », estime le sociologue. Selon lui, l’écologie, la solidarité et la démocratie en sont les priorités. Puis viennent l’égalité femmes-hommes et culturelle. Des considérations qui restent pourtant à la marge lorsqu’il s’agit d’éducation. « Mais attention, “à la marge” ne signifie pas qu’elles ne sont pas importantes, mais qu’elles ne sont pas présentes au centre de la pédagogie. Cela parce
que les enfants y sont confrontés en permanence dans leur vie quotidienne. Elles sont donc abordées via différents prismes mais ne constituent pas un enseignement à part entière », précise-t-il.
Ainsi, il existe encore un conflit générationnel, dans lequel les parents et les enseignants sont conscients de l’évolution des grands enjeux contemporains, mais qui usent toujours de la même pédagogie. C’est alors par un autre biais que la sensibilisation aux débats du XXIe siècle s’opère : le périscolaire. Pour François Dubet, l’éducation populaire en est le parfait exemple. Même si celle-ci peut revêtir différentes formes, de la plus traditionnelle et lisse à la plus militante.
Du discours aux actes
En effet, des institutions comme la Ligue de l’enseignement, aux associations socio-culturelles à l’image des MJC ou encore aux mouvements militants comme Attac, en passant par les scouts, de nombreux organismes constituent la sphère de l’éducation populaire. Leur point commun : « positionner l’enfant en tant qu’acteur, lui faire découvrir les éléments qui lui permettront de comprendre les grands enjeux contemporains », explique Emmanuel Porte, chargé d’étude et de recherche à l‘Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep).
Il s’agit d’un enseignement complémentaire à celui délivré par l’école et la famille. L’approche pédagogique n’y est pas la même. En milieu scolaire, les enfants apprennent la nature. Dans les structures d’éducation populaire, ils s’initient aux actions pour réduire leur impact sur la planète. « On passe de l’éducation à l’environnement, à l’accompagnement vers la transition écologique », précise l’expert. Au travers d’expériences grandeur nature, d’ateliers participatifs… ils découvrent par eux-mêmes l’importance de ces enjeux. « L’éducation populaire préfère la pratique aux grands discours », traduit Emmanuel Porte.
Par exemple, à l’école, l’enfant apprendra les conséquences de la pollution. Dans sa MJC, il s’adonnera à un pique-nique et observera ensuite les détritus générés par ce dernier. Deux pédagogies différentes, complémentaires.
Des apprentissages qui doivent devenir des réflexes
Ces nouveaux apprentissages sont désormais fondamentaux car ils bousculent nos pratiques sociétales. « Notre progéniture devra organiser la société de demain, elle doit donc en maîtriser les grands enjeux », explique le chercheur de l’Injep, pour qui ce processus doit être initié dès le plus jeune âge : « Les actions que pourront mener les enfants sont de l’ordre du comportement. Ainsi, plus petits ils les mettront en place et plus naturels seront leurs actes. »
Leur volonté de grandir en prenant en compte ces enjeux sociétaux est de plus en plus visible. Elle est proportionnelle à leur prise de conscience. « Les jeunes souhaitent se réapproprier ce monde qui semble s’emballer et leur échapper », constate Emmanuel Porte. Chaque génération fait son expérience de radicalité en la matière car les problématiques évoluent en permanence. Mais c’est toujours aux enfants, aux jeunes que revient la lourde tâche de s’y attaquer. « Il faut donc les armer. Leur apprendre à les interpréter. Leur donner des clés de compréhension », énumère le chercheur.
Pour cela, plusieurs outils existent, et le JT se propose de vous les faire découvrir en partie tout au long de ce dossier. Des psychologues y expliquent comment éveiller les enfants à ces grands enjeux contemporains sans toutefois les effrayer. Vous y trouverez des activités de sensibilisation pour tous les âges, et sur de nombreux sujets existentiels différents. Et plusieurs solutions pour les préparer aux transformations du monde de demain, dont les clés sont entre leurs mains.



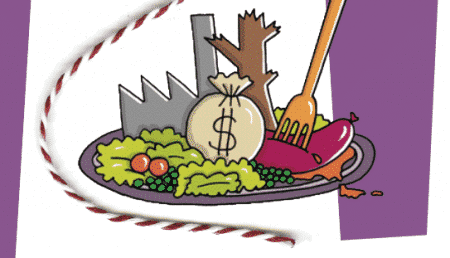


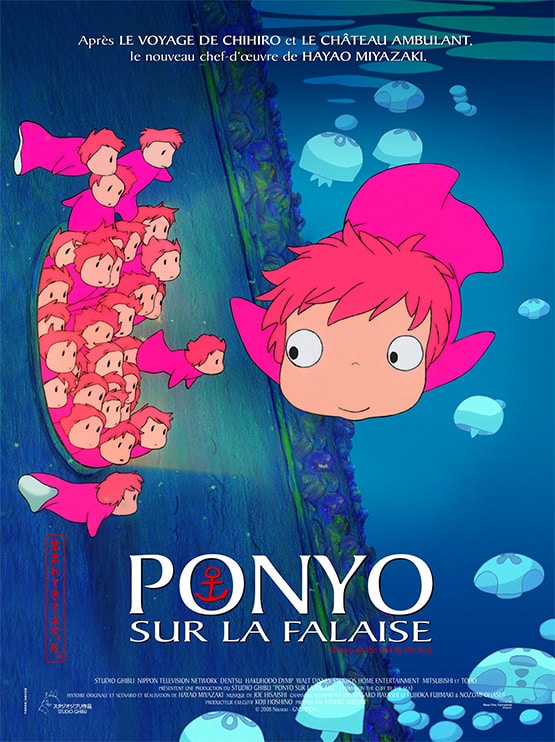

Commentaires