[RDV de La Pergola] Inquiétudes autour de la blanquette
22 janvier 2015 - 08:00
Conséquences. Depuis les événements tragiques du 7 janvier dernier, l’actualité française tourne autour de Charlie Hebdo. L’émotion passée, de nouveaux enjeux se dessinent. Florence Caussade, Franck Demay et Philippe David ont osé en parler. Des manifestations anti-françaises à l’unité nationale, en passant par le rôle de l’école, une discussion à bâtons rompus s’engage entre nos invités.
Par Myriam Balavoine et Thomas Simonian
Les présentations sont faites, et c’est autour des manifestations anti-françaises survenues dans le monde, notamment au Niger, Pakistan, Mali, en Algérie, Mauritanie, Russie ou encore Syrie, que le déjeuner commence. Honneur aux dames, «la galanterie est une valeur qui se perd» lance déjà notre boute-en-train Philippe David. À Florence Caussade donc, qui fête ce jour ses 39 ans, de débuter : «On prône la liberté d’expression, mais c’est à mon avis un prétexte pour exprimer beaucoup d’autres choses. D’un point de vue sécuritaire, cela fait peur. On a réveillé la haine de pays auxquels il ne manquait pas beaucoup pour brûler des drapeaux français.» Le secrétaire d’Etat de Barak Obama, John Kerry, confiait récemment dans une interview que la une du dernier Charlie Hebdo serait floutée dans les médias américains, dans une volonté d’apaisement des relations internationales. Mais est-il possible d’apaiser ces pays en pleine effervescence ? Pour Frank Demay, «il faut prendre en compte les différences de culture. Charlie Hebdo est une culture de liberté et de provocation. C’est aussi la liberté de ces pays que de réagir de la sorte. À nous d’essayer de les comprendre». Nos trois invités s’accordent à mettre en avant un message de «tolérance, de compréhension et d’adaptation pour des relations saines.» Une parenthèse s’ouvre concernant la remontée fulgurante de François Hollande (+21%) dans les sondages. Franck Demay s’interroge sur cette «versatilité de l’opinion publique qui réagit sous le coup de l’émotion. La conscience citoyenne française a-t-elle une mémoire ? ».
Philippe : «Ces gens n’ont rien compris ! Pourquoi brûler des drapeaux et des églises ? Charlie Hebdo n’est pas le gouvernement français et ce journal est aussi dur avec la religion catholique qu’avec l’Islam !»
« On ne peut pas accepter que des gens soient attaqués pour délit de blasphème »
Évoquant les massacres perpétrés par Boko Haram, entre autres, le directeur commercial ajoute : «Est-ce que des caricatures sont plus graves que tuer 2000 personnes ? Je ne crois pas. Et c’est ce deux poids, deux mesures qui m’insupporte». Si nos convives considèrent ces manifestations inquiétantes au Proche et Moyen Orient, notamment au Pakistan qui possède l’arme nucléaire, ils reviennent sur les rassemblements qui ont eu lieu en France.
Franck : «Les gens ont utilisé ce moment pour se retrouver, avec une envie de communion, de partage.»
Philippe : «On ne peut pas accepter que des gens soient attaqués pour délit de blasphème en 2015. Je pense que beaucoup de gens sont descendus dans la rue pour la liberté d’expression.»
Nous passons au plat de résistance, et au sujet suivant. Si l’union s’est faite dans la rue, cela n’a pas été forcément le cas dans les cours d’école. De nombreux enseignants ont été déconcertés par la réaction de certains de leurs élèves lors de la minute de silence en hommage aux victimes des attentats. Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’éducation nationale prépare un plan sur la laïcité et les inégalités. Enseigner les faits religieux, revenir à la morale d’antan et restaurer les rites républicains, sont autant de pistes explorées. Qu’en pense-t-on autour de la table ?
Florence : «L’école est le reflet de ce qu’il se passe dans le pays entier. Certains ne se sont pas rendus aux manifestations de la semaine dernière, ils peuvent être les parents des élèves qui ont refusé cette minute de silence. C’est l’expression d’un malaise plus profond qui trouve son expression dans le cadre scolaire.»
Nous touchons là du doigt la problématique de la laïcité. Franck Demay concède que «l’école, véritable révélateur, n’est pas un vase clos mais l’expression de la société civile». Si être enseignant doit être extrêmement compliqué aujourd’hui, en tous cas plus que dans les années 80, c’est parce que «les enfants ont une parole plus libre, plus nature, qu’un adulte formaté aux règles de l’éducation». Pour l’élue murétaine, «l’école ne peut pas tout faire et la famille tient un rôle très important. La vie est un tout, l’éducation doit être transversale.» Tous trois considèrent que la religion fait partie de la sphère privée et que le dialogue entre parents et enseignants est indispensable. Encore faut-il que les uns comme les autres acceptent ce dialogue. Dans une société conflictuelle, où le hashtag #JesuisKouachi a été relayé des milliers de fois, Franck Demay soulève «l’échec global de la politique tenue dans les banlieues qui a créé ces phénomènes d’intolérance.» Philippe David, lui, regrette que les gens aient «baissé les bras pour acheter la paix sociale». Les rôles forts de l’école sont de transmettre des connaissances et des valeurs, mais aussi apprendre le vivre ensemble. Pour nos invités, «les propositions de Najat Vallaud-Belkacem ne changeront rien pour ces jeunes qui n’ont plus de repères et plus confiance en rien.»
C’est autour d’un café gourmand que nous abordons le dernier sujet à l’ordre du jour. L’unité nationale est de mise en ce moment. La classe politique semble quasiment unanime depuis quelque temps. «Cela ne va pas durer !» lance Franck. « La limite de l’exercice est de revenir à la réalité de la politique et de l’économie.» estime Philippe. «Cela s’arrêtera la semaine prochaine, quand les chiffres du chômage vont tomber» rebondit Florence.
Franck : «Il faut distinguer ce qu’il y a derrière ce terme, entre la part de la réelle unité nationale et la part, consciente ou inconsciente, de peur. La communauté française s’est réunie pour se rassurer. Je pense que l’unité nationale est factice, la vie reprend son cours. La vie politique va reprendre ses droits.»
À trois mois des élections départementales, l’attitude des politiques, en réquisitionnant l’armée, est aussi là pour rassurer les Français face à des «actes de guerre sur le sol français». Finalement, peut-être que nous avons assisté à «une unité de la peur, et non une unité du vivre-ensemble.» Franck Demay estime d’ailleurs qu’il faut «attendre quelques semaines, mois, pour voir si le dialogue se réinstalle, ou si la tension restera». Dans une période de crise globale dans notre société, nos invités ne croient pas en cette unité, notamment du côté des politiciens. «Cette unité des partis n’est pas possible pour des raisons structurelles. En France, la politique est un métier que l’on fait toute sa vie. À peine élue, la classe politique pense déjà à sa réélection. La France est un pays trop clivé» examine Philippe David. La conversation continue un moment en off, comme on dit. Des sujets qui n’auront pas laissé nos invités de marbre, agrémentés de nombreuses anecdotes du quotidien et d’exemples historiques.
Mini-bios
Florence Caussade
Cette murétaine pur sucre est engagée politiquement dans sa ville depuis de longues années. Elle a été l’adjointe aux sports de l’ancien maire Alain Barrès, avant de rejoindre les bancs de l’opposition depuis qu’André Mandement (PS) est devenu l’édile. Lors des dernières élections municipales elle était la numéro deux de la liste menée par Alain Sottil.
Philippe David
Ce cadre dirigeant à l’international est un fan des médias. Il a longtemps suivi l’actualité du football pour Le Figaro ou écrit des chroniques sur le site Boulevard Voltaire. Il débat encore régulièrement sur Sud Radio sur tout ce qui fait l’actualité dans le « 12-14 » de Sophie Chaulaic et Cyril Brioulet. Il est auteur de plusieurs ouvrages, et prépare un essai sur les religions. En plein dans l’actu !
Franck Demay
Il est une référence dans le milieu journalistique toulousain. Il a été en effet le directeur de l’école de journalisme de Toulouse, puis le directeur général de TLT. Il s’est lancé depuis quelques mois dans une nouvelle aventure, celle de « L’essentiel », le premier portail national consacré à l’économie sociale et solidaire : « Je veux décloisonner ce secteur qui représente 10% de notre PIB. »











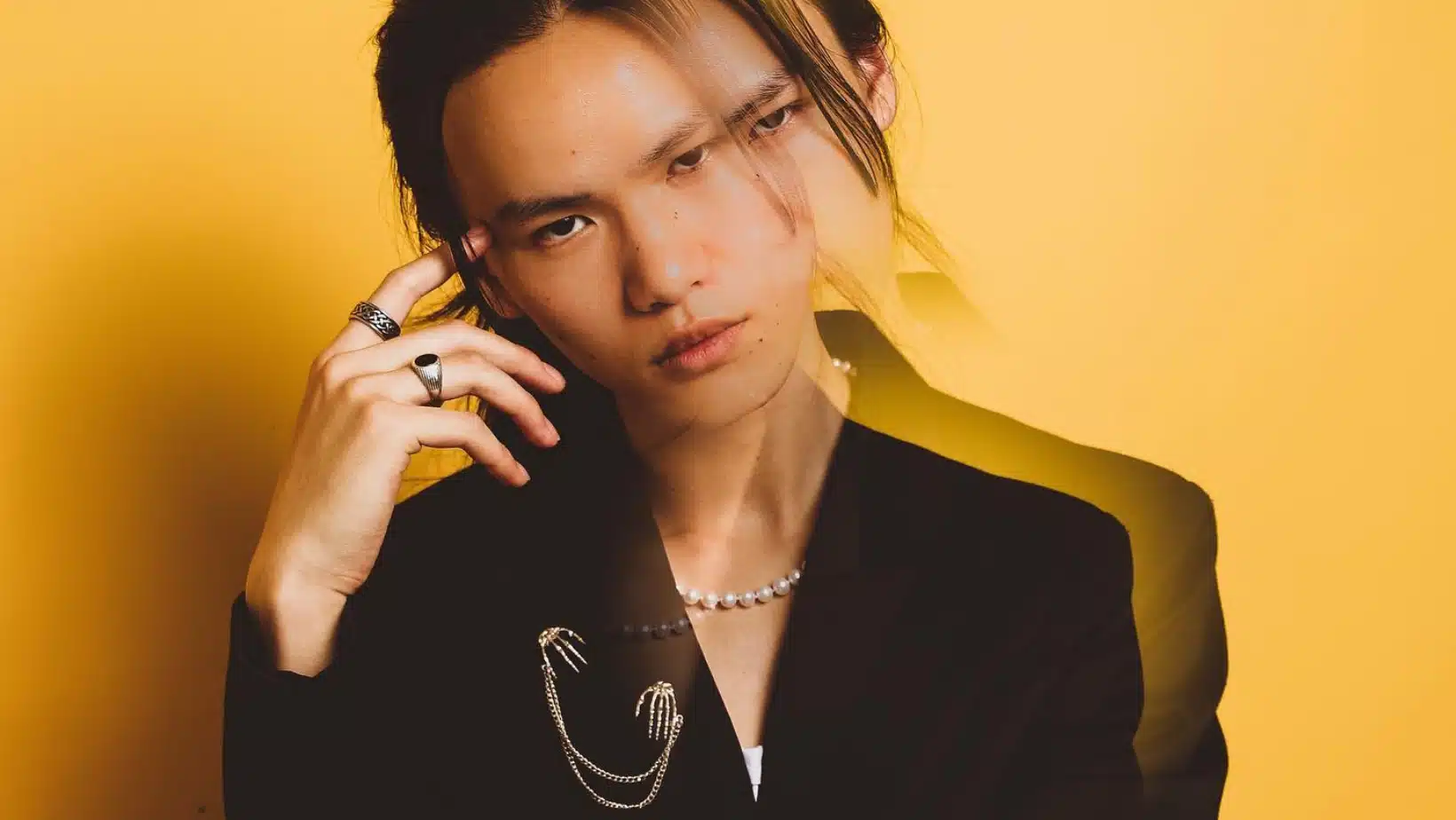


Commentaires