Toulouse comme vous ne l’avez jamais vue : 5 anecdotes qui vont vous faire lever les yeux
1 août 2025 - 18:12
Connaissez-vous ces cinq anecdotes insolites sur Toulouse ? Peut-être les avez-vous découvertes sur le compte Instagram de Laurent Moussinac, “Oh là là Toulouse”. Féru d’histoires et guidé par sa curiosité, le créateur de contenu parcourt les rues de la ville à la recherche de la moindre histoire à partager avec ses abonnés. Voici une sélection des plus inattendues.

Les férus de patrimoine et d’histoires insolites connaissent sûrement déjà son compte Instagram. Laurent Moussinac, vidéaste, est le créateur de la page “Oh là là Toulouse”, qu’il alimente depuis plus d’un an et demi. Suivi par plus de 56 000 personnes, il fait un véritable travail de recherche, en s’appuyant notamment sur les archives municipales de Toulouse, afin de partager toutes les anecdotes qu’il connaît sur Toulouse. Sous différents formats, il dévoile les secrets de la Ville rose et invite les Toulousains à devenir plus curieux.
« Je me suis dit : “Il faut rendre le patrimoine sexy et accessible”. À travers ce compte Instagram, j’essaie d’inviter les plus curieux à lever les yeux, par exemple, quand ils vont retrouver leurs amis ou faire un peu de shopping. Sur leur chemin, ils pourront peut-être croiser une rosace d’un ancien tramway, une sculpture, ou un détail dont ils ne connaissent pas l’histoire », raconte Laurent Moussinac.
Curieux et ravi de partager sa passion pour le patrimoine toulousain, le vidéaste a sélectionné cinq anecdotes les plus insolites sur la ville de Toulouse.
À quoi servent ces rosaces métalliques sur les façades de Toulouse ?

Laurent Moussinac commence par l’anecdote qui l’aura le plus marqué. Parmi ses formats, il lui arrive de faire des micro-trottoirs. Il part ainsi à la rencontre des Toulousains pour leur poser des questions en lien avec un sujet plus ou moins connu. Dans une de ses dernières vidéos, il a ainsi interrogé les passants sur l’utilité des « rosaces métalliques présentes en hauteur sur de nombreux murs du centre-ville ».
Vous en trouverez en effet au niveau de la place Esquirol, au-dessus du restaurant Le Bibent, place du Capitole, ou encore rue Alsace-Lorraine. Et non, ces objets ne servaient pas à accrocher des lanternes ou des lampadaires, ni à indiquer le Nord et le Sud, comme les personnes interrogées l’ont suggéré.
La réponse, c’est Juliette, médiatrice culturelle à Toulouse, qui la donne à Laurent Moussinac. Cette dernière dévoile alors que ces rosaces métalliques étaient des « poulies de fixation pour les câbles aériens du tramway » à Toulouse. Celui-ci est, en effet, devenu électrique en 1906. C’était un moyen de transport très populaire dans la Ville rose puisque dans les années 1930, il existait « une trentaine de lignes » qui desservaient le centre-ville ainsi que la périphérie. Et cela a duré jusque dans les années 1957, où le tramway a laissé sa place à d’autres modes de transport.
70 ans plus tard, de nombreux vestiges de l’heure de gloire du tramway toulousain sont toujours visibles sur les façades de la ville. « Nous en comptons encore près d’une soixantaine, rien que sur la rue d’Alsace-Lorraine », souligne Laurent Moussinac.
Ces grilles ont déménagé plusieurs fois dans Toulouse

À Toulouse, on aime bien déplacer le mobilier. C’est le cas notamment avec le monument aux combattants de la Haute-Garonne, situé dans le quartier de François-Verdier. Pour ceux qui ne l’auraient pas remarqué, il n’est effectivement pas à sa place initiale. Il a été déplacé pour assurer les travaux nécessaires à la troisième ligne de métro. Mais ce n’est pas la seule infrastructure à avoir déménagée dans la Ville rose.
Fasciné par le moindre détail, Laurent Moussinac a découvert que, dans le même quartier, certains éléments, désormais ancrés dans le paysage, ont connu d’autres vies. « Savais-tu que la grille monumentale du Grand Rond, ou Boulingrin, n’a pas toujours été là ? » lance-t-il à ses abonnés.
Il poursuit : « En effet, elle a été fabriquée par le ferronnier Joseph Bosc, qui a réalisé plusieurs ouvrages à Toulouse avant d’installer la grille en 1784 au Cours Dillon. D’ailleurs pour la petite anecdote, au lieu des 35 672 livres estimées, la grille a finalement coûté 54 000 livres, ce qui lui a valu un tour en prison. »
Mais un an plus tard, dans la nuit du 23 au 24 juin 1785, Toulouse est touchée par une grande crue de la Garonne. Les dégâts sont considérables tant sur le plan humain que sur le plan matériel. Au total, 208 personnes sont mortes dans la catastrophe et plus de 1 000 maisons ont été détruites.
La grille du Cours Dillon n’y échappe pas. Endommagée, elle est d’abord installée devant les Augustins en 1896 avant d’être à nouveau déménagée au Grand Rond en 1965.

Des restes d’anciens ponts sous la Garonne

Cette grande crue de 1875 aura fait d’importants dégâts dont certains ont un impact encore aujourd’hui à Toulouse. Enfin, en quelque sorte… Si vous vous baladez le long de la Garonne notamment à hauteur de la pointe Nord du Cours Dillon et du quai de Tounis, ou encore entre les quais de la Daurade et l’Hôtel Dieu Saint-Jacques, vous pourrez remarquer la présence de bouées jaunes dans le fleuve. Si elles sont très pratiques pour les bateaux, elles cachent elles aussi un pan de l’histoire de Toulouse.
En effet, ces bouées jaunes leur indiquent la présence d’objets peu profonds qu’ils doivent absolument éviter. Et c’est peu dire, car ces « objets » sont les ruines submergées des piles de deux anciens ponts.
Le premier était un aqueduc romain qui s’est effondré en 1281. Laurent Moussinac cite alors les archives de Toulouse : « L’an 1281 et la veille du jour de l’Ascension, une partie du Pont-Vieux s’écroula pendant que la Confrérie des Bateliers de la Dalbade faisait sur la Garonne sa procession accoutumée. Les spectateurs qui s’étaient portés en grand nombre sur ce pont furent entraînés dans sa chute et 200 personnes périrent dans les eaux du fleuve ».
Le second, le pont de la Daurade, a permis aux Toulousains de traverser la Garonne de 1176 à 1639. Date à laquelle l’ouvrage reliant la Daurade à l’Hôtel Dieu a commencé à être démoli. Seules deux piles subsistent alors dans l’eau. Finalement, il n’en restera rien, puisque l’une sera détruite par la fameuse crue de 1875 et l’autre sera démolie en 1950. « Seul vestige encore sur pied : la première arche et une plateforme sur laquelle se trouvait alors une tour de défense », ajoute le vidéaste de Oh là là Toulouse.
Des briques dessinées sur le Capitole ?

Parmi les anecdotes insolites que Laurent Moussinac aime partager sur Toulouse, l’une concerne la façade du Capitole. C’est un des monuments incontournables de la Ville rose, et vous êtes nombreux à passer devant tous les jours. Pourtant, un détail vous a sûrement échappé.
Si vous vous approchez de la façade du Capitole et que vous la regardez en détail, vous vous rendrez compte que l’appareillage de la brique, c’est-à-dire, la manière dont les briques sont disposées, n’est pas exactement ce qu’il paraît.
En effet, c’est Frédéric Neupont, qui tient le compte Instagram Toulouse et la brique, qui dévoile la supercherie dans une vidéo. Il explique alors que la façade a été réalisée à partir de briques foraines, autrement appelées “toulousaines”, faites en terre cuite. Un matériau que l’on retrouve notamment dans les voûtes des caves de la Ville rose ou sur les murs de certains bâtiments. La fameuse brique rouge de Toulouse. Le palmier de l’église des Jacobins ou la façade de la basilique Saint-Sernin en sont des exemples parlants. Cette brique a une particularité : elle est relativement plate. Ses dimensions, à l’époque, étaient de 36 centimètres de longueur, 26 de largeur et 4 de hauteur.
Frédéric Neupont ajoute : « Sur la façade du Capitole, on voit que les joints sont en apparence bien alignés, un rang sur deux. » Il poursuit : « Et si nous regardons bien, nous nous rendons compte qu’ils ont été repeints. Il y a de vrais joints qui ont été peints en rouge, tandis que certaines briques ont été coupées en deux, par un “faux joint”. Ainsi, ils sont bien alignés, alors qu’à l’origine, en accord avec la tradition constructive toulousaine, les joints n’étaient pas du tout alignés verticalement. »
Une mystérieuse fente sur la façade des Augustins

Enfin, actuellement fermé, le musée des Augustins recèle bien des secrets. Pour cette dernière anecdote, Laurent Moussinac est retourné dans les rues de Toulouse afin d’interroger à nouveau les passants. Cette fois-ci, sur un détail visible depuis l’espace public.
Direction le parvis du musée des Augustins où le vidéaste de “Oh là là Toulouse” a cherché à piéger les passants avec la question suivante : « À quoi pouvait bien servir cette ouverture sur la façade du musée ? » En effet, la prochaine fois que vous passerez devant le bâtiment, prenez cinq minutes pour vous placer au niveau du square Édouard Privat et regarder le mur du musée à votre gauche. Le long d’une gouttière, vous pourrez alors apercevoir une immense fente verticale.
Certains Toulousains ont imaginé qu’elle pouvait servir de meurtrière comme dans les châteaux-forts, afin de défendre l’édifice au Moyen Âge, et d’autres ont pensé que cela pouvait servir à évacuer les pots de chambre. La réponse est bien plus simple.
Pour rappel, l’édifice abrite le musée des beaux-arts de Toulouse. Ce dernier a été installé dans l’ancien couvent des Augustins en 1795. Et cette fente a été particulièrement utile pour le musée, comme l’explique Isabelle, guide-conférencière, interrogée par Laurent Moussinac : « Elle servait tout simplement à faire passer les tableaux qui étaient trop grands et qui ne pouvaient pas passer par la cage d’escalier, comme par une grande boîte aux lettres verticale. »
Elle a d’ailleurs été utilisée pour la dernière fois en 1995, lorsque le musée a envoyé une de ses œuvres phares à Paris : le tableau d’Eugène Delacroix.







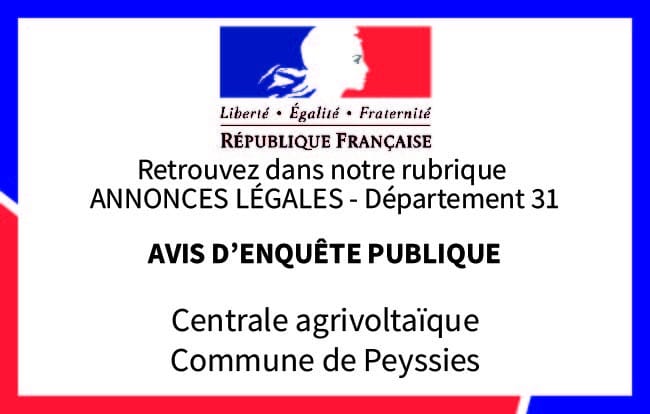

Commentaires