“Comment pouvez-vous les défendre ?” : l’avocate de Cédric Jubillar raconte la réalité de son métier
13 mai 2025 - 13:22
L’avocate toulousaine Emmanuelle Franck a publié “Comment pouvez-vous les défendre ?” aux éditions de L’Observatoire, en février dernier. Dans cet ouvrage, elle nous fait découvrir la réalité de son métier à travers l’histoire d’un violeur en série qu’elle a défendu pendant plusieurs années.

“Comment pouvez-vous les défendre ?”. Voici le titre de l’ouvrage de l’avocate toulousaine Emmanuelle Franck, publié en février dernier aux éditions de L’Observatoire. Une réponse en 261 pages à cette question qu’on lui a si souvent posée. Emmanuelle Franck est effectivement avocate pénaliste au barreau de Toulouse et défend depuis des années des criminels, des hommes accusés de féminicide et de viol. D’ailleurs, l’avocate a choisi comme fil rouge de son ouvrage l’histoire d’un violeur en série qu’elle a représenté pendant près de dix ans, appelé D. dans le livre. « C’est un des criminels que j’ai suivi le plus dans la durée et avec lequel j’ai le plus échangé sur ce qu’il a commis ; sept viols et une tentative de meurtre. Des crimes qui sont atroces, donc. Mais c’était un gamin de 20 ans qui pleurait à chaque fois que j’allais le voir, qui essayait de comprendre pourquoi il était comme ça et qui me répétait qu’il ne voulait plus être ainsi, qu’il voulait devenir quelqu’un de bien en sortant de prison. Ce qui est assez rare, surtout pour ce type de faits qui suscite une certaine perversité », estime Emmanuelle Franck qui avoue, lors de leurs échanges, « avoir plus appris sur la nature humaine qu’en dix ans d’études et de pratiques de son métier ».
Mettre à mal « la sémantique de la monstruosité »
D. chamboule donc les idées préconçues, notamment celles de l’avocate. Et il n’est pas le seul. « Je suis la première à être surprise de l’incroyable normalité de la personne que j’ai en face de moi. Parce que même moi, je m’attends à quelque chose d’un peu hors norme. Après lecture de certains dossiers, je me demande quelle tête va bien pouvoir avoir le type qui a commis de tels crimes. Et puis quand je le rencontre pour la première fois, je me demande ce qu’il a pu bien se passer pour qu’il en arrive là, lui dont l’apparence est des plus normales », confie-t-elle. Ce fut donc le cas pour D. L’avocate s’oppose ainsi à « la sémantique de la monstruosité » qu’elle a pu retrouver dans certains articles sur cette affaire. Elle rapporte ainsi que D. était décrit comme « un monstre froid et prétentieux, un prédateur sans humanité, sans empathie ; un étalage de détails et de descriptions supposés confirmer que l’auteur de ces viols ressemblait parfaitement à ce qu’il a commis ». Alors qu’il n’en était rien, selon elle.
« Ce cliché permet aux gens de se dire qu’ils n’ont rien à voir avec ces criminels. Ils déshumanisent les criminels pour se rassurer. Or, la plupart du temps, ce sont des personnes tout à fait normales », affirme-t-elle avant d’ajouter : « Le crime est désespérément humain. » Une évidence que la pénaliste essaie de faire ressortir lors des procès. « Le rôle de l’avocat est d’arriver à créer des moments d’identification entre les jurés et l’accusé. Il faut qu’ils puissent s’identifier à lui par certains aspects, qu’ils se disent qu’ils ont eu le même problème dans l’enfance ou que ça leur rappelle quelqu’un de leur entourage. Dès qu’il y a identification, cela atténue le mythe de l’atrocité. Maître Catala [avocat pénaliste toulousain auprès de qui elle a fait ses armes, NDLR] disait qu’il faut, au fur et à mesure du procès, tendre un fil entre les jurés et l’accusé, puis tirer sur celui-ci pour les rapprocher », indique Emmanuelle Franck. Et ce, « pour qu’ils jugent comme ils aimeraient être jugés ou que l’on juge l’un de leurs proches ».
Emmanuelle Franck dénonce « le lynchage médiatique »
Mais avant d’arriver à tisser ce fil, l’avocate s’efforce de garder une distance avec l’auteur des faits et surtout avec ses victimes, « pour ne pas être atteinte émotionnellement ». « Si nous sommes trop dans l’empathie, nous sommes foutus », considère la pénaliste qui poursuit : « Il faut aussi garder ses distances pour avoir un regard critique sur ce qui est dit. Il faut avoir du recul et se demander ce que nous penserions de tout cela si nous ne connaissions pas le client et si nous lisions son dossier pour la première fois, parce que c’est dans cette position que sont les juges », relève Emmanuelle Franck. Elle rappelle effectivement que « les jurés ne doivent rien connaître du dossier quand ils arrivent au procès ». En théorie, du moins. En effet, à l’heure des réseaux sociaux et des chaînes d’infos en continu, ce n’est pas toujours le cas, selon elle.
« Le problème, c’est que les jurés de demain sont les lecteurs et les auditeurs d’aujourd’hui », déplore l’avocate qui fait notamment allusion à l’affaire Jubillar. Elle défend effectivement Cédric Jubillar qui est accusé du meurtre de sa femme Delphine, disparue en 2020. « Les jurés connaissent déjà les éléments clé et ont déjà une opinion. C’est affolant », alerte la pénaliste qui dénonce par ailleurs « le lynchage médiatique » dont est victime son client. « La justice est la seule garante d’un certain équilibre. Le problème, c’est que le temps médiatique n’est pas le temps judiciaire. Beaucoup de personnes sont clouées au pilori avant même tout procès », regrette-t-elle.
Une avocate qui se rêvait psychiatre
Le « travail de déconstruction et de reconstruction » n’en est alors que plus important pour l’avocate qui s’est pris de passion pour le droit pénal. Et pourtant, Emmanuelle Franck voulait devenir médecin, comme son père, et plus précisément psychiatre. « Je n’avais jamais envisagé autre chose », affirme-t-elle. Mais, pas assez bien classée, elle n’est pas admise en première année de médecine. « Pour la première fois de ma vie, je me suis demandée ce que j’allais bien pouvoir faire d’autre », rapporte l’avocate qui choisit finalement d’aller en fac de droit.

En deuxième année, elle découvre le droit pénal et c’est une révélation. « Cela renvoyait à des notions de liberté individuelle, aux grands principes de présomption d’innocence », se souvient la pénaliste qui s’inscrit à des cours de criminologie. « J’avais l’impression de retomber sur mes pattes. Je ne me prends pas pour un psychiatre ni un médecin, mais je retrouvais un peu ce qui m’avait intéressée dans la médecine, c’est-à-dire essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des individus », partage Emmanuelle Franck qui tient à préciser : « Ce n’est pas de la curiosité malsaine. C’est parce que, devant une cour d’assises, il faut tenter d’expliquer ce qui a pu se passer dans la tête de la personne pour qu’elle soit jugée au plus proche de ce qu’elle est. »
Elle défend son client et non ses actes
Expliquer, mais ne pas excuser, comme elle le rappelle tout au long de son ouvrage. « Je ne défends pas ce que mon client a fait, je le défends lui. C’est important de le rappeler parce que dans la tête des gens, ce n’est pas toujours très clair. Il y a une réelle assimilation de l’avocat au client et à ses crimes. Certaines ont même pu dire que nous étions ses complices », révèle la pénaliste qui déplore le fait que « la profession d’avocat de la défense aux assises est très mal vue ». « Les gens pensent que nous n’avons pas de morale ni de conscience », note Emmanuelle Franck qui s’est parfois confrontée à la haine des victimes, notamment celle de D., lors du procès. « Au fur et à mesure, elles se rendent compte que nous ne sommes pas contre elles. La haine a tendance à se déliter au cours du procès. Mais ce n’est pas évident à vivre parce que nous faisons juste notre métier d’avocat de la défense », appuie-t-elle.
Au-delà des idées préconçues, Emmanuelle Franck dénonce le système carcéral actuel. « Je voudrais que la société comprenne que, dans la mesure où nous n’enfermons pas les gens à vie, ils vont ressortir à un moment donné. Il faut donc que la prison ait un sens. Mais quand vous enfermez des gens pendant 20 ans ou plus, comment pensezvous qu’ils sont rendus à la société ? », s’interroge-t-elle. « Je pense que si nous considérons qu’ils sont déviants, la seule sanction qui vaille, c’est d’essayer de les redresser. En clair, de les remettre dans le bon chemin par du soin, par de la psychothérapie, par tout ce qui leur a manqué et qui a fait qu’ils se sont construits de travers », plaide l’avocate qui cite notamment en exemple les prisons norvégiennes où les détenus peuvent profiter d’une bibliothèque, d’ateliers de cuisine et de jardinage, faire du yoga et du cheval, suivre des formations ou encore travailler. Un modèle qui semble avoir fait ses preuves puisque l’avocate indique que la Norvège présente le taux de récidive le plus bas du monde et les taux de réinsertion les plus élevés.







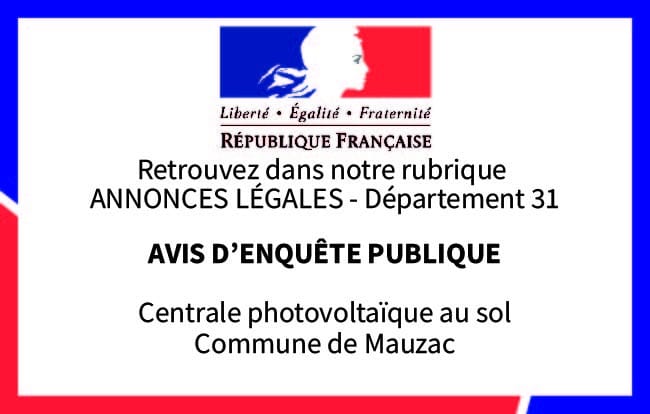

Commentaires