[Dossier] Exclure la violence de l’école
19 avril 2018 - 08:00
TABLEAU NOIR. À Galliéni, Colomiers, Borderouge et ailleurs. Dans les écoles, les collèges et les lycées, trois mots ont une tendance fâcheuse à se répéter : ras-le-bol. Même s’ils veulent éviter la caricature d’une école à feu et à sang, les enseignants sont en première ligne d’une violence scolaire qui s’installe insidieusement. Mais si l’on accepte que ce climat dégradé n’est pas seulement le fait de causes extérieures et peut être généré par les conditions de travail à l’intérieur même des établissements, les solutions sont à portée de main. Le JT a rencontré ceux qui veulent apaiser l’école.
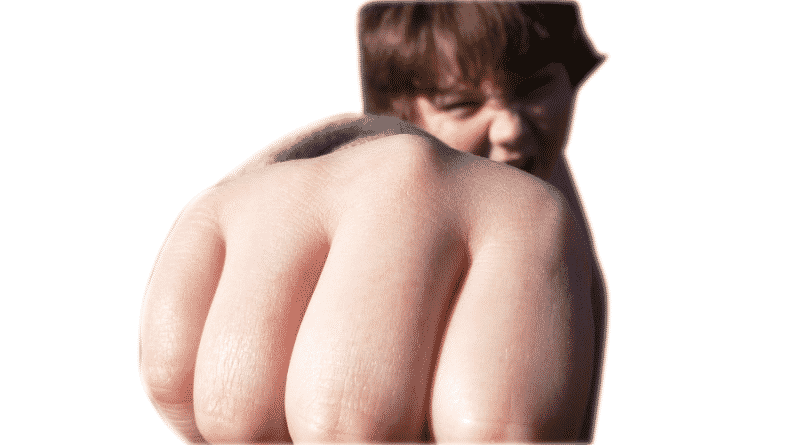
© Verekedős A Gyerek
En janvier dernier, les professeurs du lycée Joseph Galliéni exprimaient leur souffrance devant une situation devenue ingérable. Le 29 mars, c’est une institutrice de l’école primaire Jules-Ferry de Colomiers qui était agressée par trois élèves. Aussi spectaculaires soient-ils, ces deux épisodes traduisent surtout l’installation d’une violence ordinaire, pas uniquement physique. Un phénomène dont les chiffres officiels ne reflètent « qu’une petite partie de la réalité », selon Georges Fotinos, ancien inspecteur général de l’Éducation nationale. Pour y voir plus clair, ce dernier a mené une enquête auprès de plusieurs milliers d’enseignants et de chefs d’établissements au cours de l’année scolaire 2016/2017. Il en ressort qu’une personne sur deux déclare avoir été insultée au moins une fois, une sur quatre menacée et 3 % des interroges ont reçu des coups. « Les auteurs de ces violences sont en majorité les parents », ajoute l’expert qui, dès les années 1990 avait théorisé la notion de climat scolaire pour analyser cette violence : « Dans deux collèges de Trappes (dans les Yvelines ,ndlr), de même taille et avec le même environnement culturel, il se trouvait que l’un avait organisé 80 conseils de discipline dans l’année et l’autre aucun.
« En Île de France, on continue d’exclure 400 élèves par jour, l’équivalent d’un collège entier ! »
Conclusion: les phénomènes de violences ont aussi des causes endogènes à une structure et pas seulement extérieures comme on se bornait à le penser jusque-là ». Des expériences ont donc vu le jour, ici et là, basées sur de véritables projets globaux d’établissements et se sont avérées probantes. Mais n’ont pas essaimé, au grand regret de Georges Fotinos : « En Île de France, on continue d’exclure 400 élèves par jour, l’équivalent d’un collège entier ! C’est plus simple que de prendre le temps de construire un projet. »
« C’est surtout le manque d’encadrement que nous pointons du doigt »
À Toulouse, la situation décrite par des enseignants d’une quinzaine d’écoles élémentaires et maternelles des quartiers Nord illustre concrètement la dégradation de ce climat scolaire. Dans le Livre noir de Toulouse Nord, ils ont recensé tous les dysfonctionnements susceptibles de créer de la tension. Il y est question de locaux inadaptés et mal entretenus, de mauvaise organisation ou encore de défaut d’espace. « La taille des établissements est un élément important et statistiquement corrélé à l’apparition d’incidents mais c’est surtout le manque d’encadrement que nous pointons du doigt », affirme Jean-Philippe Gadier, secrétaire départemental du syndicat SNUIpp-FSU. La Haute-Garonne figure ainsi parmi les dix départements qui ont le taux le plus faible d’enseignants. Diminution de Réseaux d’aides aux élèves en difficulté (Rased), de places en établissements spécialisés, ou encore d’auxiliaires de vie scolaire), « les professeurs se retrouvent en plus avec dans leur classe un enfant qui accapare 80 % de leur attention », assure Jean-Philippe Gadier. Pour ce dernier, cette situation est le résultat d’une vision politique : « Quand on veut attaquer un service public, on le laisse d’abord dysfonctionner avant de l’abandonner aux mains du secteur privé. »
Sources : Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail. Fédération des Autonomes de Solidarité (FAS), Insee










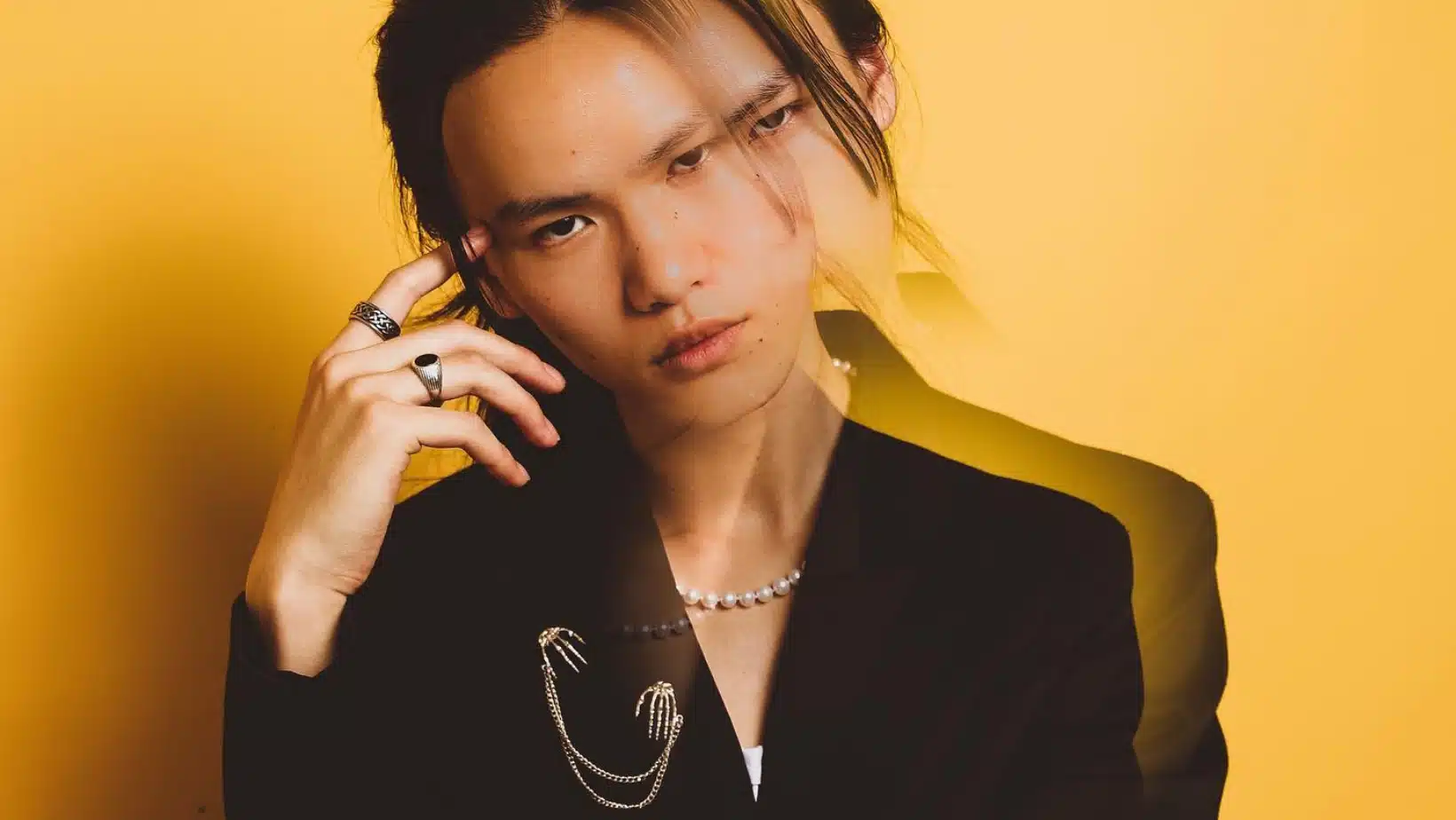




Commentaires